La vérité sur l’affaire
Ce soir, plus de porte, plus de chaise, plus de crêpes, plus de câlins, plus de parfum, plus de « mon cœur », plus de bredele, plus de toi.
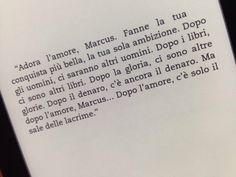
Ce soir, plus de porte, plus de chaise, plus de crêpes, plus de câlins, plus de parfum, plus de « mon cœur », plus de bredele, plus de toi.
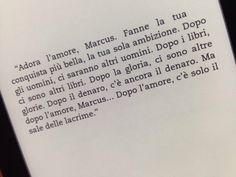
La seule chose dont je me souviens, c’est le ronronnement réconfortant du moteur qu’on allume. Un bruit reconnaissable parmi tant d’autres, mais dont la puissance me donne une sensation de sécurité. Je suis assise dans un fauteuil, la tête appuyée contre le hublot. Je n’ai même pas eu le temps de voir le décollage.
Lorsque j’ouvre à nouveaux les yeux, il n’y a que du bleu à l’horizon. Parfois quelques touches de blanc, de celles qui secouent quelques instants et qui peuvent parfois lever le cœur, mais généralement ce n’est qu’un nuancier cyan dans le ciel. Au-dessus des nuages, loin des tumultes de la terre ferme, nous volons.
Je ne sais pas vraiment où nous sommes et à vrai dire, cela me rassure. Ce vol, c’est un moment de quiétude arraché à la vie réelle, un apaisement octroyé par la force et qui ressource. Qui que vous soyez, je ne serai pas joignable. Vous ne saurez pas même où je me situe sur la surface du Globe : pour la seule fois de la journée, je vous échappe. J’échappe au reste du monde et je peux enfin être moi-même. Je peux lire ce livre tant de fois commencé et jamais terminé, prendre le temps de découvrir les journaux coincés au niveau de mes genoux et même discuter avec mon voisin. Une hôtesse me demande si je préfère le salé ou le sucré. Les nuages me font penser à des montagnes de Marshmallows. Ce sera sucré pour cette fois.
Parfois, à travers le hublot, il est possible de distinguer nos voisins des airs. D’autres avions quadrillent le ciel en laissant une traînée blanche derrière eux. Voie lactée de vapeur d’eau, vous êtes la preuve que si les hommes peuvent toucher le ciel, cela sera de manière éphémère. Promis, nous ne faisons que passer.
Le bourdonnement continue de mon navire céleste me berce à nouveau. Je ferme les yeux.
L’avion est plein. Mon cœur l’est tout autant.
Si ce n’est toi, c’est donc ta sœur. Ou ton amie. Ou ton inconnue. Celle que l’on croise tous les jours dans le métro et que l’on a envie de détester, juste comme ça, juste pour un coup de coude maladroit, juste parce qu’il faut bien une soupape et que ce matin, ça sera toi. Sans raison ou plutôt pour toutes les autres raisons que je ne saurais exprimer.
J’ai besoin de ton visage pour cristalliser en lui l’ensemble de ma colère. J’ai envie de te regarder dans les yeux et de te cracher ma rancoeur au visage. Ce visage que j’imagine aussi indigne que ce qu’il a sauvagement arraché, ce qui m’appartenait ou du moins devait m’appartenir, ces cheveux rasés qui me paraissent aussi répugnants que ces tentatives avortées de voir plus loin, de te projeter, de spolier ce qui n’est ni tien mais plus vraiment mien. Et ce faux prénom de sagesse qui m’en rappelle ton absence. Tes lèvres immondes de gorgone me révulsent, elles me tordent les tripes et me donnent envie de hurler mon dégoût.
Premier électrochoc : ce n’est pas ta faute mais ne sois pas non plus mon Valmont.
Et il y a l’autre. L’autre, cette lumière ombragée qui vole l’énergie, ce trou noir de l’existence qui aspire et ne rend jamais. Cette voleuse d’idéaux, cette Circée de pacotille qui a confondu le vide de son existence avec la profondeur de ton être. Celle que j’ai dû accepter malgré moi, parce qu’il faut parfois savoir rendre les armes pour mieux refuser ensuite.
C’est étrange la tristesse, ça fait comme une poche de vide du côté gauche. Puis ça serre au milieu.
Et puis encore l’autre. Comme un roman choral, l’autre, la consœur apatride, la visiteuse de l’autre monde, la voyageuse de l’autre cadran. Avec douze heures d’avance, c’est autant d’heures qui échappent à notre simultanéité. C’est plus facile, c’est hors du temps, c’est hors de mon existence. Pardonne-t-on ce qui est d’une autre escale ?
Victimes collatérales, coupables idéales, bouc-émissaires d’une situation qui vous dépassent, vous êtes tout ce que je ne peux comprendre et pourtant, vous êtes. Votre virtualité bleue n’est pas plus éphémère que mon envie d’effacer votre présence ici et maintenant.
Je m’assois. Perfectionniste devant le désordre, je ferme les yeux.
Aéroport vide. Le gobelet du chocolat chaud trop sucré l’est tout autant.
L’acteur est nu sur la scène. Devant plus de 600 personnes qui n’arrivent pas à détacher leur regard, dans le silence pesant d’un théâtre plusieurs fois centenaire, il est recouvert d’une épaisse cendre. Son visage porte le secret d’une âme qui s’est abandonnée pendant plus de deux heures et pourtant, dans un instant, elle va réapparaître – une seconde de silence, comme pour mieux comprendre, se rappeler, casser le quatrième mur et revenir à la vie. Reprendre son souffle pour vérifier que ce qui vient de se passer n’était pas réel, n’était qu’illusion, n’était pas la vie mais une interprétation de la vie.

Puis il y a ce geste, ce technicien qui vient apporter à l’homme nu un peignoir à nouer le long de son corps, comme si ce dernier était devenu au même instant honteux. Couvrez cette vérité que je ne saurais voir. Cette seconde précise où le comédien passe du rôle à la réalité, de l’expression artistique à l’obscénité d’une nudité publique me fascine.
Ce tissu noir descendu comme un rideau tombe sur la scène comporte en lui un degré de poésie que l’on tend à oublier. Une vulnérabilité qui pousse le comédien à son plus haut degré d’humanité. Alors seulement peut-il saluer.